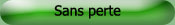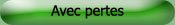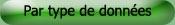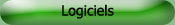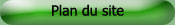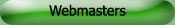Le présent site, réalisé dans le cadre du cours de Conception multimédia de l'Université Libre de Bruxelles, dans le courant de l’année académique 2005-2006, se propose d’offrir au visiteur une brève synthèse sur la compression de l'information numérique.
Qu’est-ce donc qu’un algorithme de compression me demanderez-vous ? A quoi cela peut-il bien servir ? C’est à ces questions que répond cette introduction. Les algorithmes de compression trouvent leur origine dans les besoins sans cesse croissant de stockage et de transmission engendrés par le développement du multimédia. Nous ne vous apprendrons sans doute rien en vous apprenant que les données numérisées, de quelque type que ce soit, ont un volume qui détermine leur manipulation, pour la conservation sur support physique (CD-ROM, DVD) ou leur transmission sur Internet (via la bande-passante). L’intérêt de la compression des données semble donc évident. Si vous n’êtes pas convaincu, imaginez par exemple :
- 1 seconde de vidéo composée de 25 images
- une image qui pèse 466 kilo octets
- un cédérom qui peut stocker 700 méga octets de données
Combien de secondes de vidéo ce cédérom peut-il contenir ?
Comment faire ?
Les algorithmes de compression peuvent être essentiellement envisagés sous deux angles d’approche complémentaires. Le premier angle consiste à les diviser en deux grandes familles, algorithmes sans perte et avec pertes, comprenant chacune leurs méthodes spécifiques. Le second angle consiste à aborder les différents algorithmes de compression, parfois désignés sous le terme de codec (COmpression-DECompression, essentiellement dans les domaines audio et vidéo), en fonction du type de données qu’ils sont appelés à traiter, à savoir des données de type texte, image, audio ou vidéo. On a ainsi par exemple des algorithmes de compression pour les images avec pertes et sans perte, implémentant une variété de méthodes au sein de chacune de ces deux catégories.
On a parfois tendance à grossièrement simplifier la division des algorithmes de compression en définissant deux ensembles : les algorithmes de compression sans perte pour les données de type texte ou les programmes d’une part, et les algorithmes de compression avec pertes pour les données de types image, audio et vidéo. La réalité est un peu plus subtile : c’est la destination à l’usage des données qui détermine avant tout le choix d’une option avec pertes ou sans perte. Ainsi la norme JPEG 2000, et par extension le MJPEG 2000, permettent-elles de travailler respectivement l’image et la vidéo avec pertes OU sans perte. Tout dépend en effet de l’usage auquel sont destinées les données. Le MJPEG 2000 permettant de travailler sans perte avec des fichiers – on s’en doute – substantiellement plus lourds sera ainsi utilisé essentiellement pour l’indexation et le montage vidéo, et a été à ce titre adopté comme future norme du cinéma numérique.
Ce site a pour but d’offrir au visiteur des grandes lignes de repères permettant de s’y retrouver dans ce domaine relativement complexe, sans prétendre évidemment à l’exhaustivité en la matière. Il présente donc d’une part différentes méthodes employées en matière de compression sans perte et de compression avec pertes, et d’autre part les principaux algorithmes et normes utilisés actuellement pour chaque type de données spécifique. Il offre également un aperçu de quelques logiciels permettant de compresser-décompresser différents types de données.
Nous vous souhaitons une agréable visite.